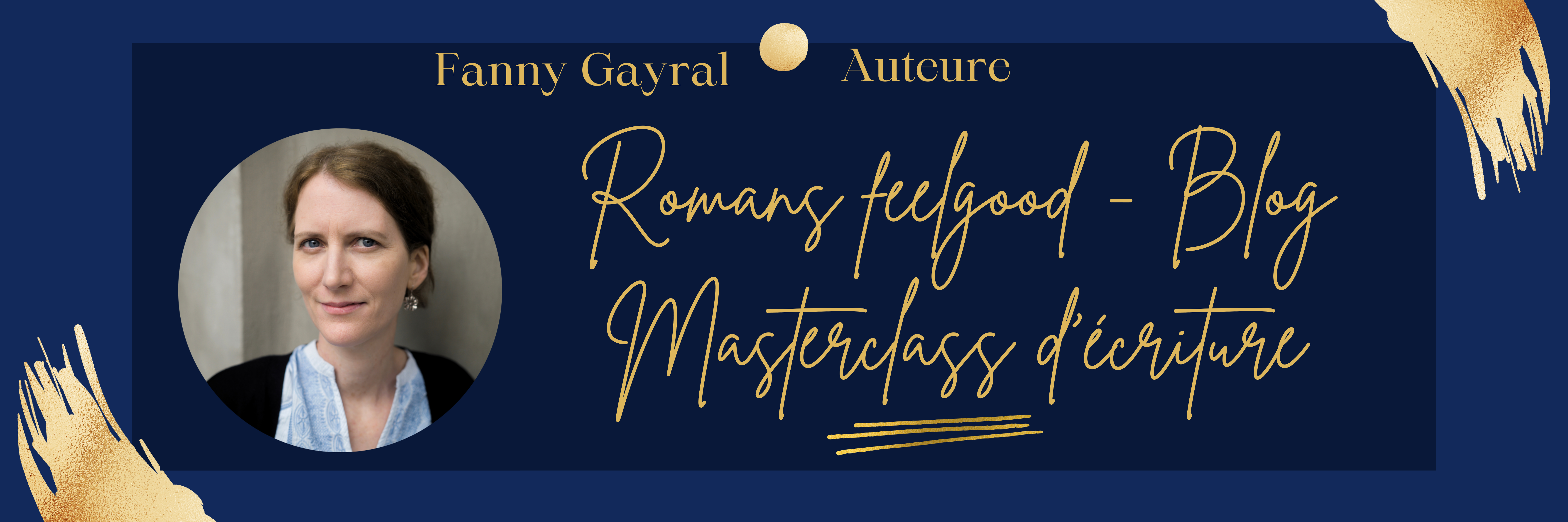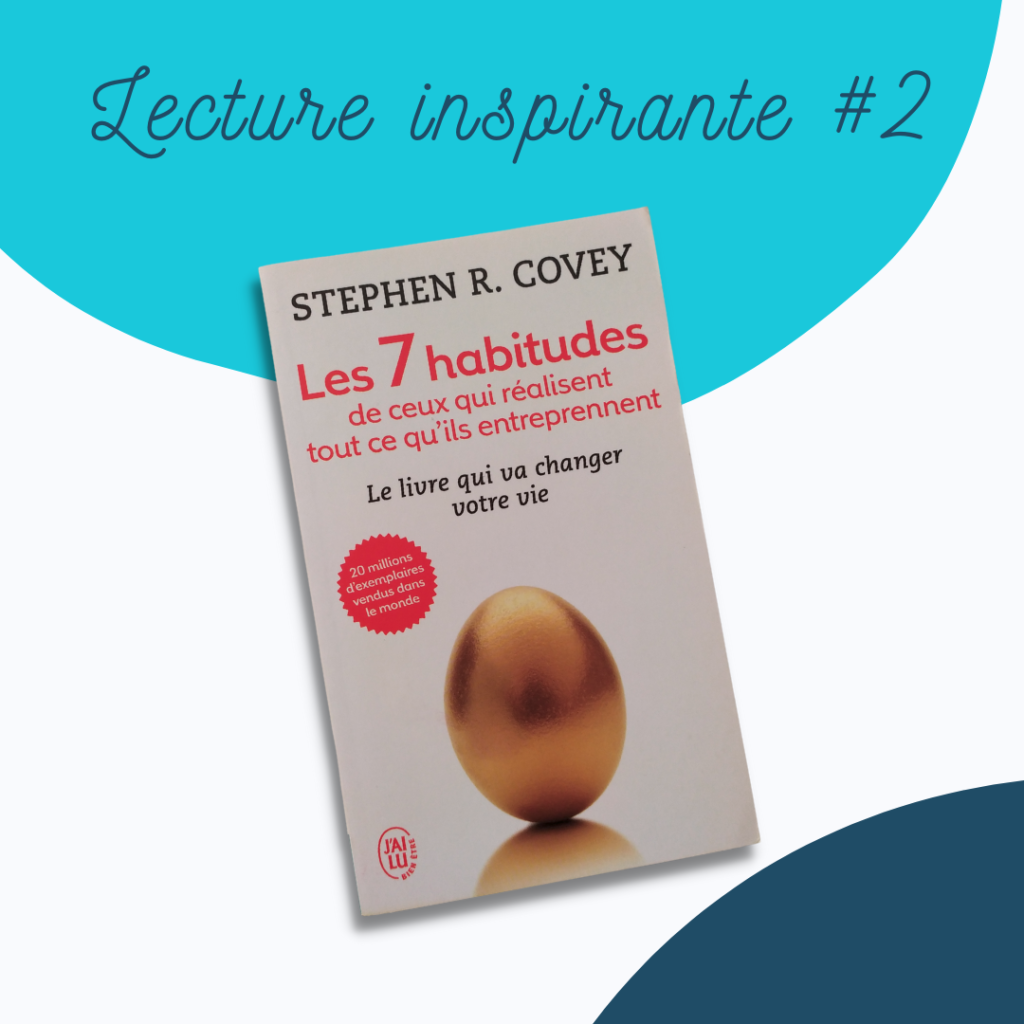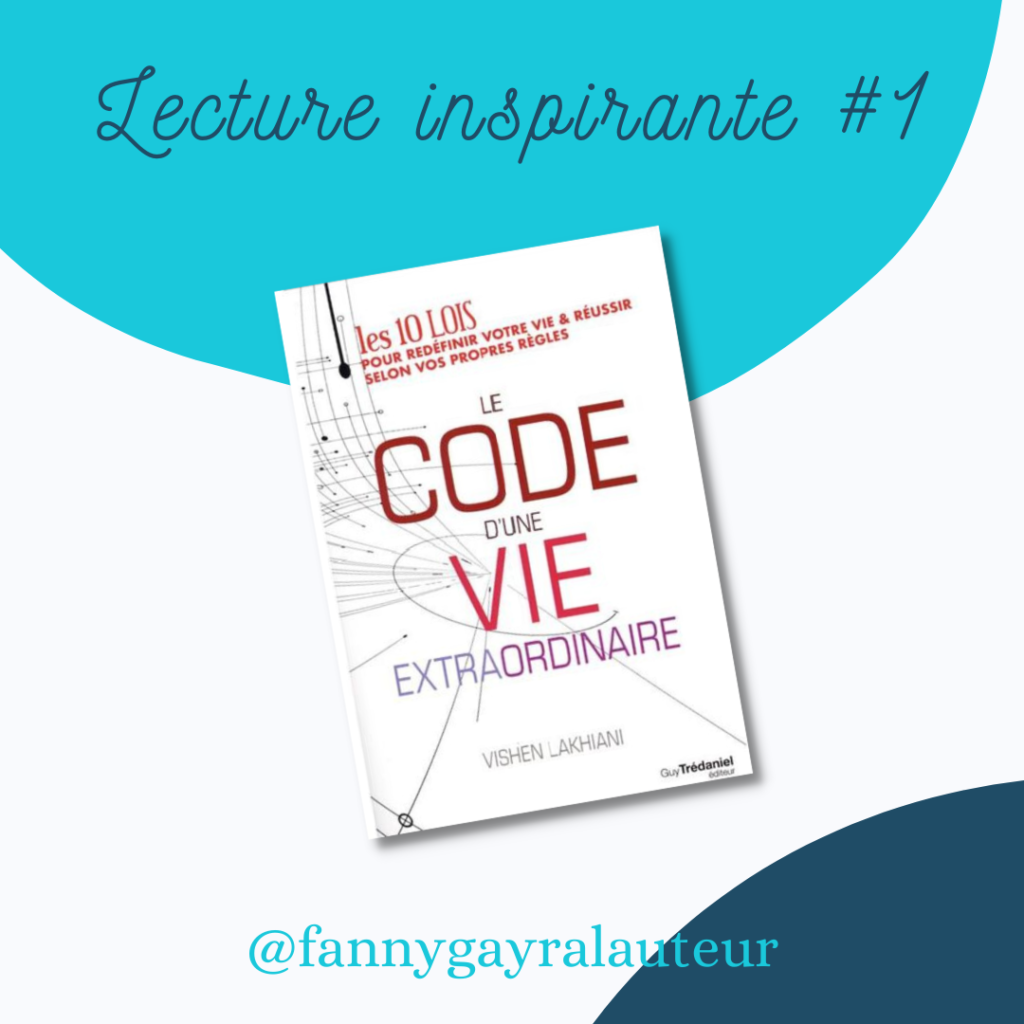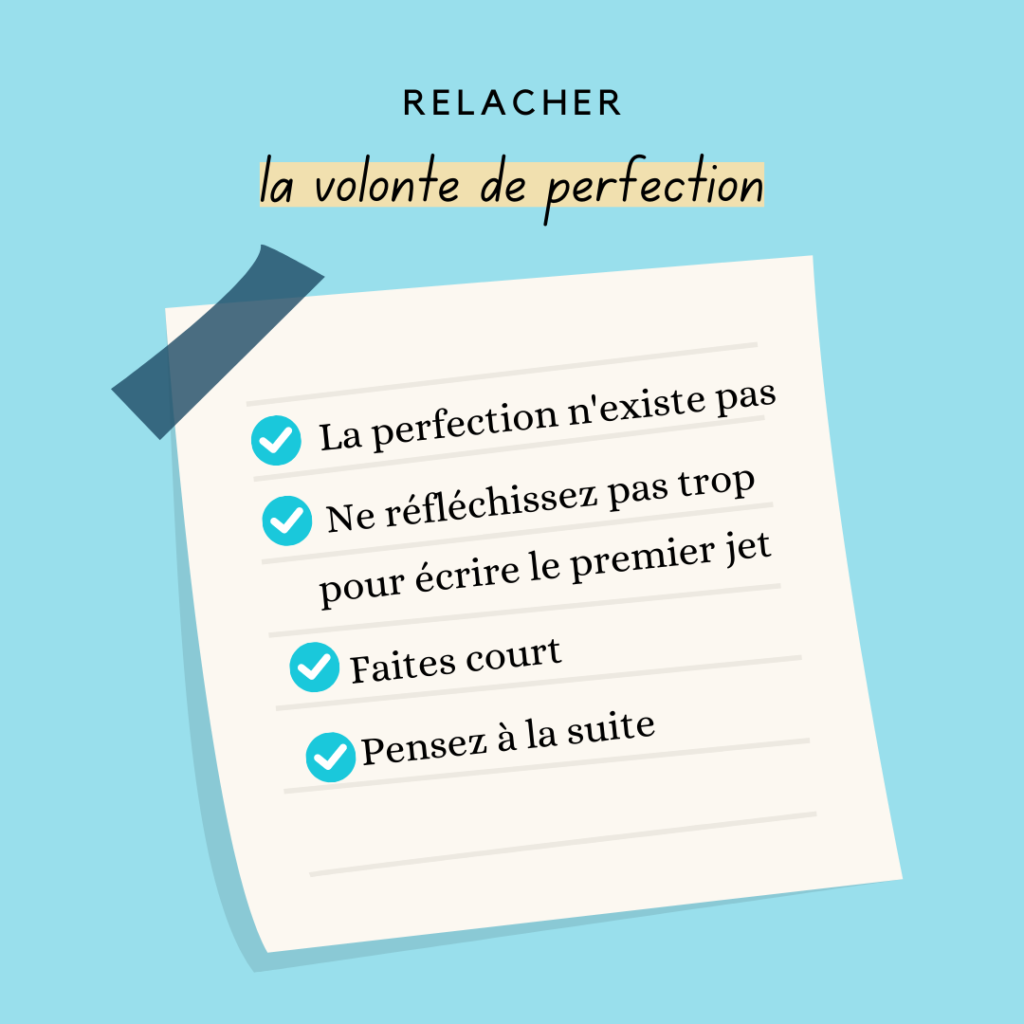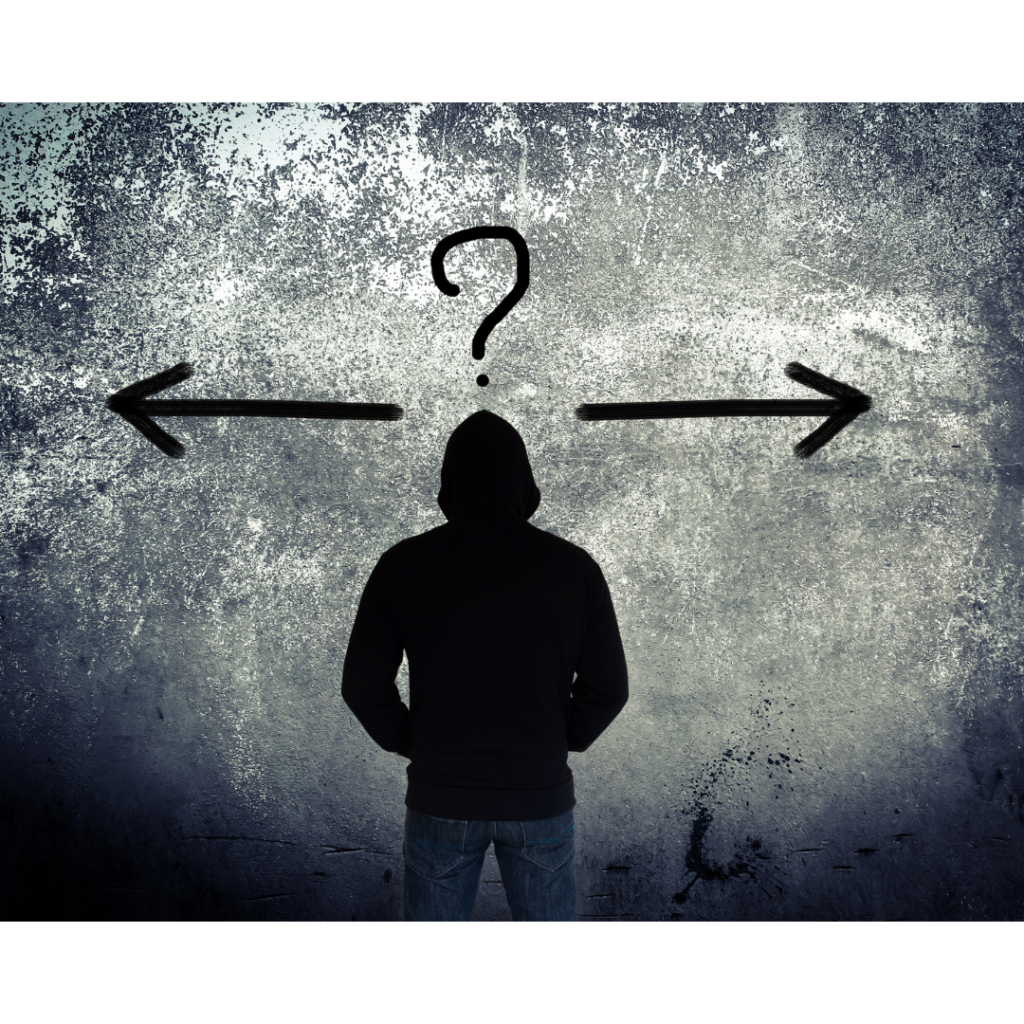
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler des personnages ratés (oui, le mot est un peu fort, mais on voit bien ainsi ce dont il s’agit. 😉 ). Ce sont ces personnages inintéressants, qui ne fonctionnent pas, auxquels le lecteur ne s’attache pas. Le personnage raté est un écueil fréquent pour les auteurs qui débutent.
En voici quelques exemples :
- Le personnage sans nuances : par exemple, trop parfait, paré de toutes les qualités (beau/belle, gentil(le), généreux(se), brillant (e)) ou encore insipide, timide, terne. Le personnage sans nuances est pourvu d’un paysage intérieur uniforme. Pour créer un personnage de roman intriguant, il faut le doter de contrastes, de particularités antinomiques ou surprenantes, d’originalité.
- Dans la lignée du personnage sans nuances, le personnage sans failles n’a pas de problème particulier, sa vie est idéale, tout va très bien pour lui, merci. Or, ce qu’attendent les lecteurs, ce sont des fêlures, des problèmes, des angoisses, des dilemmes, des échecs… bref, des choses à surmonter ou à transformer. Vos personnages doivent évoluer, ce sont ces processus de changement qui constituent l’âme de l’histoire.
- Le personnage sans but : il n’a pas d’objectifs, pas de rêves, on ne sait pas ce qu’il veut, ce qu’il espère (consciemment ou inconsciemment). Clarifier en amont les enjeux de vos personnages est primordial. C’est ce qui permet, par la suite, de leur mettre des bâtons dans les roues en actionnant des leviers antagonistes, de ne pas leur donner immédiatement ce qu’ils (et que les lecteurs) désirent.
- Le personnage inutile : il est là un peu comme un cheveu sur la soupe. Sa disparition ne troublerait ni l’intrigue principale, ni les intrigues secondaires. Il ne sert à rien, il faut le retirer pour alléger le texte. Lorsque plusieurs personnages paraissent partiellement inutiles, on peut aussi les regrouper en un seul, plus consistant, plus complexe.
- Le personnage flou : on ne connaît ni son passé, ni ses goûts, ni ses relations à sa famille, ni son métier (et pour couronner le tout, il a les yeux bleus à la page 10, et les yeux marrons à la page 152). Le personnage flou n’a pas été suffisamment construit par l’auteur. C’est un inconnu pour tout le monde (l’auteur comme le lecteur), il nuit à la tension narrative, qui se nourrit de précision et de clarté.
Qu’en pensez-vous ? Avez-vous déjà eu ce genre de problème avec vos personnages ?